Le tokenisme handi : je ne veux plus être votre faire-valoir
- Laetitia Rebord
- 11 août 2025
- 5 min de lecture

J’aimerais aujourd’hui vous parler d’un phénomène insidieux, trop peu nommé mais omniprésent dans les milieux associatifs, professionnels, militants ou institutionnels : le tokenisme handi, ou encore le handi-washing.
C’est quoi le tokenisme handi ?
C’est quand on invite une personne en situation de handicap « pour faire bien » mais sans réelle volonté d’inclusion ni reconnaissance de ses compétences. On vient chercher l’image, la caution morale, l’effet vitrine, mais pas la compétence, ni la rémunération, ni la collaboration durable. C’est exactement comme le greenwashing dans l’écologie : un emballage dit progressiste qui cache une réalité inchangée, voire oppressive.
C’est donner la parole à une personne concernée... mais ne pas l’écouter. L’inviter à une table ronde... mais ne pas la payer. L’ajouter sur un programme... mais ne pas lui donner de pouvoir de décision. L’intégrer dans un projet... mais l’effacer une fois qu’il est lancé.
Ce que j’essaie de vous dire, c’est que ce n’est pas de la reconnaissance : c’est de l’instrumentalisation.
Mon parcours : entre expertise et invisibilisation
Je suis paire-aidante en santé sexuelle et handicap. J’ai fondé Sexpair® en 2021, une entreprise engagée, où je mets à disposition mes savoirs expérientiels et professionnels, pour accompagner mes pairEs, faire évoluer les représentations, déconstruire le validisme, et proposer des outils d’éducation à la sexualité hybride.
À peine lancée, j’ai été sollicitée par les centres IntimAgir, des dispositifs mis en place à la suite du rapport Piveteau-Wolfrom et du plan d’action gouvernemental pour mieux accompagner la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de handicap. L’objectif affiché est de garantir un accès effectif aux droits sexuels et reproductifs, à travers des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement. Chaque centre est censé réunir des professionnelLEs forméEs (travailleureuses sociales/aux, sexologues, éducateurices, etc.) capables de proposer un accompagnement respectueux des choix et besoins des personnes concernées.
Ces centres sont portés par des structures comme des associations gestionnaires du médico-social, des CREAI (Centres régionaux d'études, d’actions et d’informations), ou encore certains Plannings familiaux.
Sur le papier, l’initiative est louable. Mais dans les faits, on constate souvent un écart entre l’intention et la mise en œuvre : peu de place est réellement donnée aux personnes concernées, que ce soit dans la gouvernance, la formation ou l'intervention. L’expertise des personnes en situation de handicap est parfois réduite à un témoignage, un simple apport ponctuel, sans reconnaissance financière, ni intégration à long terme. Le risque est grand de tomber dans le "handi-washing", en affichant une volonté d’inclusion sans mettre en place les moyens structurels pour qu’elle soit réelle et durable.
On m’a appelée à leur création pour donner des conférences, animer des groupes d’expression, partager mon expérience, porter ma parole de concernée. À ce moment-là, tout le monde semblait raviE d’afficher que « oui, on a demandé à une personne handi ».
Mais aujourd’hui, alors que ces centres sont officiellement créés, structurés, financés... je ne suis plus référencée quasi nulle part. Invisible. Ignorée. Évincée.
Alors je pose la question : était-ce pour mon expertise, ou juste pour votre image ?
Quand on me demande de travailler gratuitement… pour des événements payants
Récemment, une organisatrice d’un événement sur les sexualités dites « inclusives » à Strasbourg m’a contactée pour une conférence. Elle tient un love shop, m’a dit qu’il n’y avait « pas beaucoup d’argent » mais que je pouvais envoyer mon tarif, qu’elle verrait ce qu’elle pourrait faire. J’ai proposé une conférence sur le validisme en santé sexuelle.
J’ai appris ensuite que l’entrée à l’événement était payante et plutôt coûteuse. Je n’ai jamais eu de retour. Ma conférence a pourtant attiré du monde, contribué au succès de l’événement. Résultat ? Aucune rémunération, pas même un bon d’achat. Juste un stand paumé dans un coin, sans rien à vendre.
Encore une fois, j’étais là pour décorer. Pour cocher la case « diversité ». Pas pour être reconnue à la hauteur de mon travail.
« On ne vous recommande pas… parce que c’est payant »
On me dit parfois qu’on ne recommande pas mes services, parce que je fais payer. Mais le problème n’est pas l’argent : ces mêmes structures n’hésitent pas à recommander des sexologues, des sages-femmes, des psy, des pros de la santé sexuelle. Ce qu’elles refusent de reconnaître, c’est ma légitimité professionnelle, mon statut de paire-aidante encore mal reconnu en France.
Je suis compétente, je suis formée, j’interviens, j’accompagne. Et pourtant, je dois sans cesse justifier pourquoi je mérite un salaire.
Mon ancienne entreprise : 17 ans de bons et loyaux services… sans reconnaissance
Le cas le plus flagrant de cette exploitation a été mon ancienne entreprise, où j’ai travaillé 17 ans comme traductrice diplômée d’un Master 2, en télétravail.
On m’a proposé au bout de 15 ans de coordonner la politique diversité, équité et inclusion. J’ai accepté, dans l’espoir de faire bouger les lignes. J’ai permis à l’entreprise d’obtenir la certification Qualiopi, un sésame financier. Je l’ai fait gratuitement, sans modification de contrat, sans reconnaissance formelle.
Un jour, j’ai proposé de devenir officiellement Référente handicap. On m’a répondu que ce n’était pas obligatoire car on était « moins de 250 salariés ». Oui, mais je faisais déjà ce travail !
Un étage entier restait inaccessible sans ascenseur. L’installation aurait coûté 70 000 €. Or, l’entreprise versait chaque année 30 000 € à l’AGEFIPH faute d’employer suffisamment de personnes handicapées. J’ai montré que deux ans d’embauche de personnes handicapées suffisaient à amortir l’investissement. Réponse ? Le silence.
J’en ai eu assez d’être la mascotte handicapée, celle qu’on exhibe lors des événements inclusifs… mais qu’on n’écoute pas. J’ai démissionné, désabusée. Exploitée. Invisibilisée.
Ce n’est pas juste mon histoire : c’est systémique
Ce que je vis, je ne suis pas la seule à le vivre. Ce n’est pas un cas isolé, ni un « malentendu ». C’est systémique.
Le validisme, ce système qui dévalorise les personnes handicapées, est ancré dans toutes nos institutions, nos pratiques professionnelles, nos façons de penser. On invite les personnes concernées… mais on ne les rémunère pas. On applaudit leur parole… mais on ne change rien derrière. On se donne bonne conscience… sans jamais partager le pouvoir.
Tant qu’on ne reconnaît pas que le problème est collectif, structurel, systémique, rien ne changera.
Je ne veux plus être votre caution handicap. Je veux être reconnue comme professionnelle, comme actrice de changement, comme humaine à part entière.
Et je ne suis pas la seule.
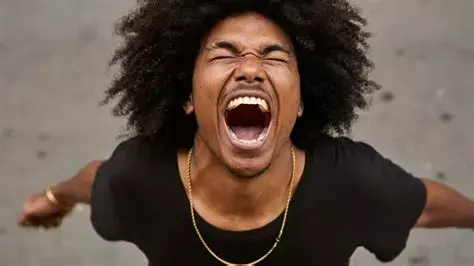


Commentaires